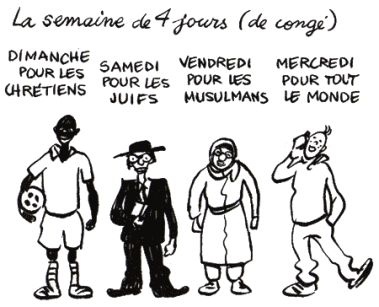Le voile intégral en France
 |  |  |
|---|---|---|
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
En quoi le voile intégral et la laïcité en France sont ils contradictoires ?
Pour finir, la laïcité française face au voile intégral
3.1 Voile intégral, symbole de radicalisation et du communautarisme
Des mouvements de populations d’origines culturelles diverses contribuent depuis des siècles à la construction de la France. Ces différentes populations qui composent le pays coexistent sans forcément se connaître ni se reconnaître, pouvant parfois se refermer sur elles-mêmes et s’exclure mutuellement. Dans le même temps, les individus et notamment les jeunes, issus de ces populations, ont la sensation d’un manque de respect et de reconnaissance de leur histoire alors même que beaucoup d’entre eux la méconnaissent souvent.
Le voile intégral constitue la revendication la plus symbolique du communautarisme musulman.
- Différents types d'Islam :
L'islam est une religion ressentie différemment par chaque musulman : les plus extrêmes (adeptes du voile intégral) pensent à l'instauration de la loi islamique et séparent le monde entre croyants et impies, les premiers devant mener le djihad contre les seconds.
Mais c'est une interprétation limitée. Du fait, sous le terme musulman se rangent à la fois des personnes pour qui la foi ne définit pas une identité politique et qui moulent leur pratique religieuse sur le modèle des autres religions présentes en france dans le cadre de la laicité et de la nationalité ; et d'autres qui instrumentalisent la citoyenneté et la nationalité au service d'un projet qui n'est que communautaire et confessionnel. Au final, chacun à sa façon de pratiquer, de croire en sa religion, il y a donc différents " types" de musulman, allant de l'extremiste, au simple croyant.
Une expérience a été menée par Gilles Kepel (professeur a sciences-po), montrant la diversité des pratiques religieuses de l'islam.
Tous les répondants s'estimaient « vrais musulmans » :
Au cours du mois du ramadan, 3 groupes se distinguent de l'echantillon à la question "accepteriez vous d'aller manger chez un non-musulman" :
- Le premier : autoforclusion ou citadelle intérieure : il n'est pas question de manger chez un non-musulman.
- Le second : imprégnés d'une logique communautaire, rien ne s'y opposait a condition de manger « halal ».
- Le troisième : dont la logique de la différence était assurée individuellement, ne voyait pas d'objection à la réserve pres qu'ils ne mangeraient pas de porc ni ne boiraient de vin.
Aujourd'hui a côté des musulmans pour qui la foi relève de la sphère privée, d'autres voient dans la religion le fondement même de leur existence sociale et politique ; les papiers sont juste un moyen pour acquerir des avantages sociaux, ne pas être expulsé... etc, la prégnance culturelle de la france, l'allégance a quelque valeur dont elle se réclame, ne fait plus sens.
- La montée du communautarisme religieux :
- Le « communautarisme » désigne un mode d’organisation politique conférant des droits spécifiques à des groupes ou communautés fondés sur la religion, la culture, la race ou l’ethnicité.
- Dans une démocratie, diverses solutions sont possibles. On peut reconnaître des communautés en leur accordant un statut collectif propre, ainsi les communautés linguistiques en Belgique ou les minorités dans un grand nombre d’États en Europe.
On peut seulement accepter leur existence sociale sans que des droits spécifiques leur soient reconnus, c’est le cas en France où l’on peut parler de communauté juive ou de communauté « pied-noirs ». La France n’est pas « communautariste » au sens où, la seule communauté juridiquement admise est celle des citoyens, les groupes n’ayant d’existence que pratique mais sans reconnaissance de droits.
Ainsi, même les droits particuliers pour des populations données ne concernent que les individus, jamais le groupe comme collectif. C’est sur ces bases qu’il convient de s’interroger sur la place que l’on accorde au groupe dans la construction identitaire et culturelle de l’individu.
- Mais, aujourd'hui, en France, un repli communautaire plus subi que voulu se développe, le contexte social et urbain étant favorable au développement de logiques communautaristes, faisant primer l'allégeance à un groupe particulier sur l'appartenance à la République.
Ce phénomène était, jusqu'à ces dernières années, encore peu perceptible en France. Quelques chiffres illustrent la gravité de cette situation. Il a été signalé (à la commission stasi) que dans 700 quartiers, accueillant de nombreuses nationalités, les difficultés se cumulent : chômage supérieur à 40%, problèmes aigus de scolarisation, signalements sociaux trois fois plus importants que dans le reste du territoire. Les habitants de ces quartiers délaissés ont le sentiment d’être victimes d’une exclusion sociale qui les condamne au repli sur eux-mêmes.
C’est notamment le cas des plus jeunes : 32% de la population y a moins de vingt ans.
Dans certains cas l'école et le sport ne permettent plus de lutter contre ce repli communautariste, car ils ne parviennent plus à assurer leur fonction de brassage social.
Les enfants des classes moyennes fuient vers le secteur privé ou obtiennent des dérogations à la carte scolaire : les écoles sont parfois devenues socialement et ethniquement homogènes.
De plus en plus de femmes sont exclues des stades et des piscines. Des clubs féminins ou mixtes disparaissent. Le peu de dialogue interculturel ou de valorisation des cultures dans une logique d’échange aggrave cet état de fait.
Cet ensemble de phénomènes sape la confiance dans la République et l’identification à la nation. Il nourrit un repli communautaire plus subi que voulu dans bien des cas.
- Pressions de groupes communautaristes politico-religieux, instrumentalisation du voile intégral :
Des groupes communautaristes politico-religieux exploitent alors ce malaise social réel pour mobiliser des militants. Ils développent une stratégie d’agression contre des individus afin de les plier à la norme communautaire qu’ils préconisent. Ces groupes agissent ainsi dans les quartiers relégués en soumettant les populations les plus fragiles à une tension permanente. C'est notamment le cas des groupes islamistes qui prônent un islam radical.
Il en va ainsi des pressions qui sont exercées sur des jeunes filles ou jeunes femmes pour qu'elles portent une tenue donnée et respectent des préceptes religieux tels que ces groupes les interprètent, sous peine de devoir s’effacer de la vie sociale et associative. Une grave régression de la situation des jeunes femmes est constatée : «La situation des filles dans les cités relève d'un véritable drame» : par ces termes, une dirigeante associative a mis en lumière que les premières victimes de la dégradation de la situation sociale sont les femmes. Une autre jeune femme (intérogée lors de la comission Stasi) a résumé la situation ainsi : «La République ne protège plus ses enfants ».
Les jeunes femmes se retrouvent victimes d’une réapparition du sexisme qui se traduit par diverses pressions et par des violences verbales, psychologiques ou physiques. Des jeunes gens leur imposent de porter des tenues couvrantes et asexuées, de baisser le regard à la vue d'un homme ; à défaut de s’y conformer, elles sont stigmatisées comme «putes».
47 associations s'alarment des démissions de plus en plus fréquentes de leurs adhérentes d'origine étrangère, qui se voient interdire par leur milieu l’engagement dans la vie associative. Dans ce contexte, des jeunes filles ou des femmes portent volontairement le voile, mais d'autres le revêtent sous la contrainte ou la pression. Il en va ainsi des fillettes pré- adolescentes à qui le port du voile est imposé, parfois, par la violence.
Les jeunes filles, une fois voilées, peuvent traverser les cages d’escalier d’immeubles collectifs et aller sur la voie publique sans craindre d'être conspuées, voire maltraitées, comme elles l'étaient auparavant, tête nue. Le voile leur offre ainsi, paradoxalement, la protection que devrait garantir la République. Celles qui ne le portent pas et le perçoivent comme un signe d'infériorisation qui enferme et isole les femmes sont désignées comme «impudiques», voire «infidèles».
Certains voudraient revenir a des espaces séparés, a l'enfermement des filles et des garçons dans des stéréotypes traditionnels, et transformer une coutume sociétale, un dogme religieux, en loi de la nature. Des normes communautaro-religieuses seraient ainsi supérieures aux lois de la république.
Pour les intégristes, le voile, est une tactique subtile et habile : il amalgame l'enfant et le voile qui la cache, l'être humain et son signe d'appartenance à une communauté religieuse. Il ôte à ces adultes en devenir toute chance d'explorer le champ de leurs possibles. Il leur ferme tout l'espace de la culture, de la pensée.
La multiplication des jeunes filles et femmes voilées est le résultat le plus visible du discours religieux dominant. En intervenant dans le domaine familial et social, les religieux fondamentalistes augmentent ainsi leur influence politique.
Le probleme devient très grave pour des jeunes filles, qui, même quand elles ne veulent pas se conformer aux normes traditionnelles, sont progressivement obligées de le faire.
Le voile est devenu un signe d'allégance politique. Le voile porté aujourd'hui est le même partout, c'est un uniforme.
- Le voile intégral : ou les femmes retirées a la visibilité du monde
Pour les familles qui élèvent leurs enfants en leur faisant croire que les garçons sont naturellement supérieurs et que les filles doivent être soumises au père ou aux freres avant de l'être a leur mari, l'opposition avec les principes républicains est frontale. La norme transmise par la religion patriarcale est le respect absolu de l'autorité et de la supériorité masculine avec pour corollaire l'intégration par les filles de cette subordination.
Le voile dévoile le statut de la femme. Et d'abord celui de son corps. D'après les musulmans radicaux, le corps d'une femme doit être mit à l'abri des regards. Il ne s'agit pas de protéger la femme, il s'agit de protéger l'homme contre la tentation du corps féminin.
Le voile s'accompagne d'un habit qui sert à nier les formes du corps féminin, à les faire disparaître. C'est à dire qu'il y a un lien entre le voile et la réclusion. C'est en raison de son infériorité que la femme est tenue au port du voile. La femme qui le porte intériorise cette infériorité : elle se soumet donc, non pas seulement a une norme, mais à l'autre sexe.
Il fut un temps ou le signe de la libération de la femme était d'enlever le voile. Le retour du voile ajourd'hui est la marque d'une grande régression.
Il est loin le temps ou bourguiba, président de la République entre 1957 et 1987 en Tunisie, à la fin des années 1950 arpentait les rues de Tunis pour enlever le voile aux femmes :
Le voile est moins un signe ostentatoire d'appartenance a la religion musulmane que celui de la soumission de la femme.
Le voile est un instrument qui prend place dans tout un sytème de ségrégation et d'exclusion de la femme : il vise à interdire le corps de la femme, qui est pensé comme pervers et menaçant à l'égard de l'ordre social, entendu que cet ordre est masculin.
Les islamistes utilisent le voile intégral comme une ruse : comme ils ne peuvent plus enfermer complètement la femme , ils proposent d'inclure cette exclusion dans l'espace public.
Les femmes portant le voile intégral sont non seulement exclues de toute la société, mais n'ont plus aucune identité, il est impossible de savoir qui ce cache derrière ce masque, impossible d'identifier la personne. Ces femmes sont complètement coupées du monde.
La conséquence de cette vison unilatérale du religieux est de rendre difficile voir inacceptable les différentes manifestations de l’islam qui "débordent" de la sphère privée. Les revendications de musulmans, perçues d’emblée comme suspectes et quelquefois arriérées, provoquent des réactions hautement émotionnelles.
- Concilier laicité et diversité culturelle :
«A la mosquée, au moins, j’existe !» : cette exclamation en forme d’avertissement, entendue par la commission Stasi, sonne comme un véritable échec de la politique d’intégration des vingt dernières années.
En un siècle la société française est devenue, sous l’effet de l’immigration, diverse sur le plan spirituel et religieux. L’enjeu est aujourd’hui de ménager leur place à de nouvelles religions tout en réussissant l’intégration et en luttant contre les instrumentalisations politico-religieuses.
Il s’agit de concilier l’unité nationale et le respect de la diversité. La laïcité, parce qu’elle permet d’assurer une vie commune, prend une nouvelle actualité. Le vivre ensemble est désormais au premier plan. Pour cela, la liberté de conscience, l’égalité de droit, et la neutralité du pouvoir politique doivent bénéficier à tous, quelles que soient leurs options spirituelles.
Mais il s’agit aussi pour l’Etat de réaffirmer des règles strictes, afin que ce vivre en commun dans une société plurielle puisse être assuré. La laïcité française implique aujourd’hui de donner force aux principes qui la fondent, de conforter les services publics et d’assurer le respect de la diversité spirituelle. Pour cela, l’Etat se doit de rappeler les obligations qui s’imposent aux administrations, de supprimer les pratiques publiques discriminantes, et d’adopter des règles fortes et claires dans le cadre d’une loi sur la laïcité
Nier la force du sentiment communautaire serait vain. Mais l’exacerbation de l’identité culturelle ne saurait s’ériger en fanatisme de la différence, porteuse d’oppression et d’exclusion. Chacun doit pouvoir, dans une société laïque, prendre de la distance par rapport à la tradition. Il n’y a là aucun reniement de soi mais un mouvement individuel de liberté permettant de se définir par rapport à ses références culturelles ou spirituelles sans y être astreint.
De ce point de vue, le danger est double. La dérive du sentiment communautaire vers un communautarisme figé menace de fragmentation nos sociétés contemporaines.
A l’inverse nier toute diversité ou pluralité en réaffirmant de façon incantatoire un pacte républicain désincarné serait illusoire. La laïcité d’aujourd'hui est mise au défi de forger l’unité tout en respectant la diversité de la société. Le cadre laïque peut être le lieu de conciliation de cette double exigence. Il doit se donner les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. Mais il s’agit aussi pour l’Etat de réaffirmer des règles strictes, afin que ce vivre en commun dans une société plurielle puisse être assuré. La laïcité française implique aujourd’hui de donner force aux principes qui la fondent, de conforter les services publics et d’assurer le respect de la diversité spirituelle. Pour cela, l’Etat se doit de rappeler les obligations qui s’imposent aux administrations, de supprimer les pratiques publiques discriminantes, et d’adopter des règles fortes et claires dans le cadre d’une loi sur la laïcitéDe même, le spirituel et le religieux doivent s’interdire toute emprise sur l’Etat et renoncer à leur dimension politique. La laïcité est incompatible avec toute conception de la religion qui souhaiterait régenter, au nom des principes supposés de celle-ci, le système social ou l’ordre politique.
L’Islam, religion la plus récemment implantée en France et qui compte de nombreux fidèles, est parfois présentée comme inconciliable avec la laïcité. Pourtant la théologie musulmane a produit, dans sa période la plus brillante, une réflexion novatrice sur le rapport entre politique et religion. Les courants les plus rationnels en son sein refusaient la confusion entre pouvoir politique et spirituel. La culture musulmane peut trouver dans son histoire les ressources lui permettant de s’accommoder d’un cadre laïque, de même que la laïcité peut permettre le plein épanouissement intellectuel de la pensée islamique à l’abri des contraintes du pouvoir.
La france peut etre fière de son modele d'intégration et de sa laicité. Ils sont les fruits d'une histoire longue et parfois déchirante. Mais ils permettent a chacun de jouir sans entrave de sa liberté de conscience et de son sentiment d'appartenance a une nation définie par le sol et non pas par l'ethnie ou par la race.